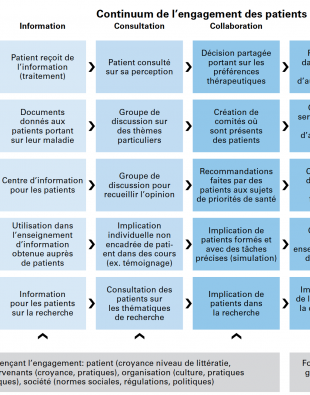« Une volonté d’ouverture est nécessaire »
Nov.. 2019Impliquer les personnes concernées
Interview. Dans un entretien commun, Martin Stucky et Daniel Scheidegger constatent que l’époque où les médecins savaient tout mieux que tout le monde est révolue. Une plus grande implication des personnes concernées et de leurs proches est profitable à toute la société.
Monsieur Stucky, Monsieur Scheidegger, la « participation des patients » est un mot d’ordre qui a une consonance démocratique et sympathique. Qu’est-ce que cela signifie pour vous, en tant que médecin ou personne concernée ?
Daniel Scheidegger: Pour moi, la participation n’est pas seulement sympathique, elle est avant tout nécessaire. En tant qu’experts, nous ne pouvons pas décider dans le dos des intéressés de ce qui est important et approprié pour eux. Toutefois, nous avons constaté au sein de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) qu’il est très difficile d’accéder aux patients. Nous avons sollicité différentes associations de patients pour qu’elles nous fournissent une liste de personnes qui pourraient nous donner le point de vue d’individus concernés au sein de nos groupes de travail. Nous espérions ainsi pouvoir avoir recours à un groupe de personnes au sein duquel nous aurions pu consulter, selon l’occasion et le besoin, une patiente de Suisse romande souffrant de troubles rénaux ou un jeune diabétique du Tessin, p. ex. Nous n’y sommes malheureusement pas parvenus à ce jour.
Martin Stucky : Je suis pour ma part en contact étroit avec des clients et des patients dans le cadre de mon activité indépendante d’accompagnant vers la guérison, mais aussi de mon travail à temps partiel en tant que conseiller téléphonique au sein de la Fondation Pro Mente Sana à Zurich. Ces rencontres et mon expérience personnelle – j’ai été atteint d’un trouble de la personnalité borderline il y a plus de 20 ans – m’autorisent, lors d’interventions publiques, mais aussi d’activités au sein de groupes d’entraide, à attirer l’attention sur le fait que les personnes concernées ont une voix et que nous aimerions être écoutés.
Dans sa publication (en allemand) sur l’implication des patients et de leurs proches, l’ASSM constate que la participation des patients est plus développée dans les pays anglo-saxons et que la Suisse a du retard à rattraper. Partagez-vous cette appréciation ?
Martin Stucky : Oui. D’une manière générale, une volonté d’ouverture est nécessaire, des deux côtés. En ce qui concerne les patients, il est clair que quiconque s’ouvre sur des sujets liés aux traumatismes psychiques baisse la garde et se rend vulnérable. Il faut avant tout du courage pour se lancer. Mais la société doit aussi se poser la question suivante : dans quelle mesure avons-nous une attitude ouverte face aux personnes qui souffrent de traumatismes ou de maladies psychiques ? Certains pays sont bien plus avancés et vont plus loin que la Suisse en la matière.
Daniel Scheidegger : Il ne fait aucun doute que c’est aussi une question de culture. En Suisse, les maladies ont tendance à être passées sous silence. Les choses commencent peut-être à changer. Il arrive de temps à autre qu’un homme politique aborde ouvertement sa maladie. Mais lorsque vous faites la queue à la caisse d’un magasin aux États-Unis, vous savez au bout de dix minutes que la personne derrière vous a subi une prostatectomie l’année précédente. En tant que Suisse, je pense parfois : ai-je vraiment envie de le savoir ?
Martin Stucky : En Suisse, notre éducation nous impose de ne pas parler de nos sentiments. Pro Mente Sana a lancé une campagne intitulée « Comment vas-tu ? » pour assouplir un peu ce principe. Nous pensons qu’il est bon et important de pouvoir parler de ce qui nous préoccupe.
Des attentes élevées en matière de participation sont formulées envers les associations de patients et les organisations d’entraide, alors que leur rôle reste souvent confus. Toutes les conditions semblent donc réunies pour que des difficultés surviennent dans cette relation de couple.
Daniel Scheidegger : Premièrement, nous ne sommes pas encore parvenus à établir une relation de couple. Et deuxièmement, nos attentes ne sont pas non plus si grandes. Quand nous voulons résoudre des problèmes qui concernent d’autres personnes, nous aimerions simplement avoir autour de la table quelqu’un qui nous indique quand nous faisons fausse route. Un exemple : j’ai longtemps été membre du comité directeur de la Fondation suisse pour paraplégiques, qui comprend toujours une personne concernée. Lorsque nous avons abordé les projets de recherche, les discussions ont tourné autour des exosquelettes et des manières de procéder pour que les paraplégiques puissent remarcher. Le paraplégique présent a alors pris la parole : la mobilité n’était pas son problème. Il était satisfait de son fauteuil roulant. Ce qui le préoccupait était sa vessie, la pose du cathéter et les infections. Nous autres n’y avions absolument pas pensé.
Martin Stucky : Je conçois mon rôle d’« expert d’expérience » au sein du conseil des personnes concernées de l’OFSP comme celui d’un porte-voix qui permet de communiquer les perceptions et les besoins des personnes concernées au monde extérieur. Cela implique toujours aussi un travail d’information et de déstigmatisation. Je constate très souvent que le public – et la société dans son ensemble – perçoit nos souffrances différemment de nous. C’est pourquoi je pense qu’il est important que les personnes concernées s’organisent et créent une plateforme. Nous encourageons les personnes concernées à faire leur « coming-out ». Je suis convaincu que cela sera de plus en plus le cas dans le futur.
Est-ce que donner du courage aux gens fait partie de votre travail d’accompagnant en guérison ?
Martin Stucky : Très certainement. J’accompagne régulièrement des personnes qui n’osent pas confier à leur employeur qu’elles traversent une crise psychologique. J’interroge toujours mes clients sur ce dont ils ont besoin pour pouvoir dire à leur chef : « Je suis préoccupé-e par ceci et cela. J’ai actuellement besoin de plus d’espace et que l’on me soulage. » Il est primordial qu’une telle déclaration n’ait aucune conséquence négative. Oser parler de ses problèmes ne doit pas mettre en péril son emploi. C’est pourtant bien trop souvent le cas, en particulier chez les personnes souffrant de traumatismes psychiques. Lorsque l’employeur se sent dépassé, il se demande si la personne reste résistante au stress et capable d’accomplir sa mission, au lieu de se pencher sur les besoins et de trouver une solution acceptable pour tous. C’est pourquoi il est important de conseiller aussi les employeurs, afin qu’ils puissent assumer leur responsabilité : veiller à offrir un bon environnement de travail.
Revenons au dialogue entre médecins et personnes concernées. Dans de nombreux cas,
il ne s’agit pas seulement des patients, mais aussi des proches. Il leur faut aussi parfois réorganiser leur vie.
Daniel Scheidegger : Oui. Lorsque les proches participent aux soins, ils doivent naturellement être impliqués, idéalement dès le début. Cela
suppose toutefois que le patient lui-même soit d’accord pour embarquer
ses proches dans cette démarche.
Martin Stucky : Dans mon travail, j’ai souvent affaire aux proches, surtout au début, lorsque les personnes touchées refusent, par honte ou par peur, d’entrer en contact avec un accompagnant en guérison. Les proches sont un facteur essentiel dans le système. Par un comportement favorable ou moins favorable, ils peuvent aussi influer sur la manière dont ils pourront continuer à faire preuve d’empathie et de bienveillance pour la personne concernée, sans que la situation ne les affecte trop. Mais comme pour la personne touchée, il faut que les proches aient la volonté de regarder les choses en face et de contribuer en partie à la solution. Lever les tabous et mettre fin à la stigmatisation est l’affaire de tous.
Depuis quelques temps, le maître mot est partout « responsabilisation du patient » ou « patient empowerment », en anglais. Mais dans quelle mesure le gain de pouvoir des patients implique-t-il aussi une perte de contrôle pour les médecins ?
Daniel Scheidegger : Pour moi, il va de soi qu’en tant que médecins, nous ne savons pas tout mieux que tout le monde. Lorsqu’un patient vient me voir avec un problème, je ne peux pas l’interrompre au bout de trois phrases pour lui prescrire des comprimés. Je dois d’abord l’écouter et essayer de comprendre de quoi il s’agit. Mais la responsabilisation des patients a aussi ses limites. De nombreux patients trouvent des offres en ligne dans lesquelles on leur fait de fausses promesses. C’est p. ex. le cas de thérapies à base de cellules souches. Contre une grosse somme d’argent, des prestataires étrangers vendent des traitements qui peuvent parfois faire plus de mal que de bien. En tant que médecin, j’aimerais que le dialogue avec les patients ait lieu d’égal à égal. Étant spécialiste, je suis malgré tout davantage en mesure de faire le tri dans la multitude d’informations liées à la santé, car je peux m’appuyer sur une solide base de connaissances acquise au cours de mes six années d’études de médecine.
Martin Stucky : Dans mon travail, je considère que la notion de « patient empowerment » implique de donner espoir et confiance. Je peux apporter mon savoir et mes expériences en tant que pair, mais en aucun cas en me mettant dans la position de celui qui sait exactement ce qu’il faut à l’autre. Je pense que déterminer quand et à quel point il est possible de déléguer la responsabilité de la situation à la personne concernée est une formidable démarche que chaque aidant – qu’il soit un proche du patient ou l’un de ses médecins – doit adopter.
Où constatez-vous une évolution dans l’implication des patients ?
Martin Stucky : En de nombreux lieux. Chez Pro Mente Sana, nous avons p. ex. constitué au cours des dernières années un « peer pool ». Il s’agit d’une centaine de personnes qui ont souffert de différentes maladies et sont désormais disposées à soutenir des personnes actuellement touchées en s’appuyant sur leur expérience. Mais l’idée fait aussi son chemin au niveau sociétal. Si, en tant que société, nous parvenons à reconnaître l’utilité et le bénéfice offerts par l’accompagnement en guérison, nous en tirerons tous des bénéfices. À cet égard, la toute première embauche d’un pair par l’Office AI des Grisons me réjouit particulièrement. Lorsque vous souhaitez réintégrer une personne avec des traumatismes psychiques, il peut être utile de collaborer avec quelqu’un qui a éventuellement vécu quelque chose de similaire et qui sait de quoi il parle.
Pensez-vous que la participation des patients devrait être soutenue financièrement ?
Martin Stucky : Oui, tout à fait. Tant que l’accompagnement en guérison ne sera pas considéré comme une prestation prise en charge par les caisses-maladie, l’aspect financier restera un gros problème pour de nombreuses personnes concernées.
Daniel Scheidegger : Lorsque nous recherchons des personnes pour notre groupe de travail, nous voulons qu’elles nous aident sans que nous leur offrions de l’aide. C’est pourquoi nous payons les participants à nos réunions en leur versant des indemnités journalières en rémunération de leur prestation.
Pour conclure : Monsieur Stucky, en tant que personne concernée, qu’attendez-vous des experts de la santé ?
Martin Stucky : Le plus important est l’ouverture et la volonté de bien écouter. La conjonction des connaissances de la personne concernée et de celles de l’expert donne naissance à un savoir commun : « Je sais » + « Tu sais » = « Nous savons ».
Daniel Scheidegger : Je suis d’accord. Lorsqu’un patient vient me voir, je dois découvrir ce qui le perturbe. S’il présente une détresse respiratoire, je ne devrais pas me concentrer sur des valeurs sanguines qui sont peut-être un peu en dehors de la norme, mais prendre au sérieux le patient et son problème. Les causes peuvent être multiples. Il ne fait aucun doute que l’objectif est plus vite atteint lorsqu’on travaille ensemble.
Et vous, Monsieur Scheidegger, que souhaiteriez-vous des personnes concernées en tant que médecin ?
Daniel Scheidegger : Je souhaite que les personnes concernées prennent davantage conscience que nous avons besoin de connaître leur point de vue et que nous aimerions qu’elles participent à nos discussions.